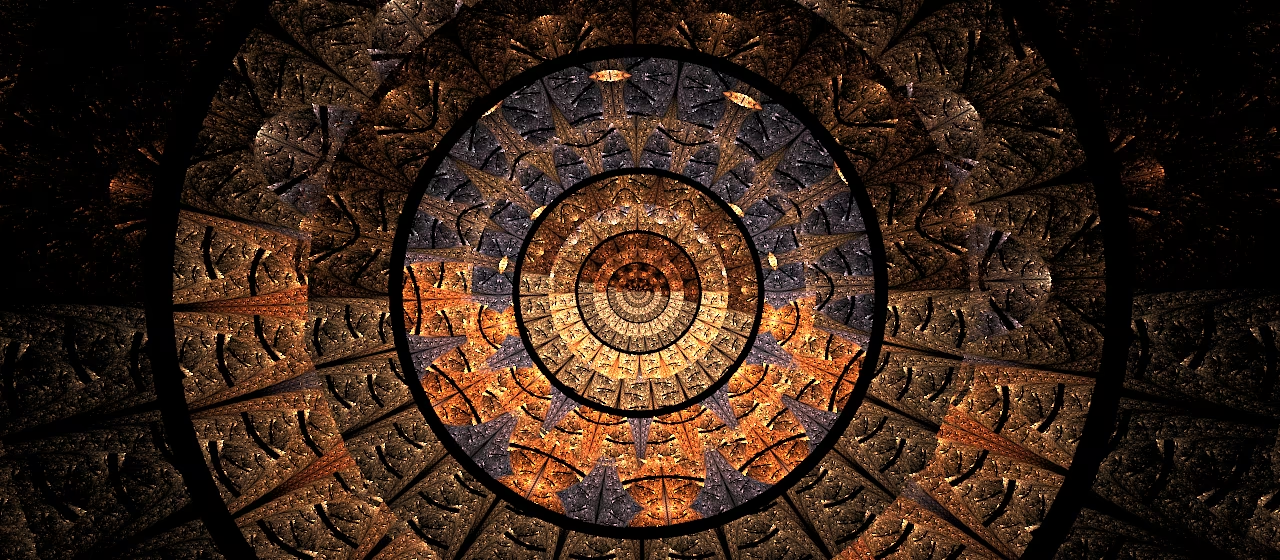
« Sache qu’à tout ce que je ne comprends pas venant de toi, j’élabore, à chaque fois, une nouvelle théorie qui est une variation infinie de ce qui me semble être toi par définition, et, je la transpose dans cette histoire que j’écris dans l’espoir de te finir. »
Ces mots, gravés dans l'ombre de ma mémoire, résonnent comme un mantra, une tentative désespérée de dompter l'incompréhensible. Il n'est pas un vide, mais une densité, un amas de possibles qui se recouvrent et se contredisent. C'est le silence primordial d'avant le langage, le chaos informe qui attend d'être sculpté par la pensée.
Ainsi commence ce mouvement perpétuel sans son infini : chaque incompréhension enfante un monde, chaque compréhension enfante un autre monde, mais ils se trouvent en un même lieu, en un même espace & temps. L'esprit, face à l'opacité de ces mondes, ne se résigne pas ; il tisse. Il entrelace les fils des relations afin de faire apparaître une trame, il fabrique des passages de mots vers l'insondable. C'est le premier geste magique qui, ne comprenant pas l'éclair, invente la foudre en mythologie. La théorie n'est pas une explication, mais une incarnation — une mise en chair de l'absence.
Je retourne voir les premiers dessins dans les grottes de la préhistoire afin plonger dans cet abîme de l'incompréhensible et de la mythologie. Ces silhouettes d'animaux, ces mains tracées sur la pierre, ne sont pas de simples représentations. Ce sont des tentatives de capturer l'essence même de l'existence, de donner forme à l'invisible. Les bases mêmes de la connaissance et du langage y sont inscrites de la manière la plus simple, la plus intuitive et la plus efficace qui soit. C’est tellement vrai que nous n’avons pas changé d’un iota ces principes de base aujourd’hui. Acmé de la technologie humaine, à jamais indépassable. Car la pierre, elle, n'a pas besoin de mots. Elle est le langage originel, le murmure de l'univers.
Là, dans le ventre de la terre, l'humain n'a pas seulement représenté le bison ; il l'a tissé avec de la terre et de l'esprit. La main qui soufflait le pigment n'est pas celle qui voit : elle est celle qui fait voir. L'outil n'est pas le burin, mais le geste qui scinde le réel en deux : l'animal qui court & qui demeure. Cette scission est le véritable feu prométhéen : non pas voler les dieux, mais se voler soi-même à l'éternel devenir de la polysémie des sens.

Les transformations opérées par le chemin de la grotte se transmuent en un labyrinthe. J’avais découvert un monde que je ne connaissais pas. Je crus lui être plus réel que la vérité. J’ai senti, dans mon corps, les années s’éclipser, le temps s’arrêter en un point de l'espace dont je n'arrivais à trouver ni le centre, ni sa circonférence. J’étais dans l’ailleurs du monde où je voulus apprendre à connaître pour ensuite transcrire, transposer, transformer, transmuer. Et j’ai vu le labyrinthe circulaire ; il me fascinait et m’apeurait.
Enfermé dedans depuis des années, je le vivais comme si j’étais à l’extérieur. Dedans, j’étais dehors. Dehors, j’étais dedans. Je compris cette division primitive au bout d’un temps certain, après des dizaines d’années de déambulations en son sein. Première étincelle qui vint de je ne sais trop où.
Tel le labyrinthe qui était dedans et dehors, j’étais et dedans et dehors. Ses murs, mes murs, ses apparences, mes apparences. Tout se transformait selon mes illusions, mes croyances, mes souhaits, mes vérités observées, mes interactions. Ce que je croyais comprendre ressemblait à une ligne d'évolution : voyant tout s'effondrer lorsque je regardais derrière moi, et, tout se façonner, à nouveau, par la manière dont je construisais devant moi les murs à partir de ces mêmes ruines qui s'effaçaient de mon regard.
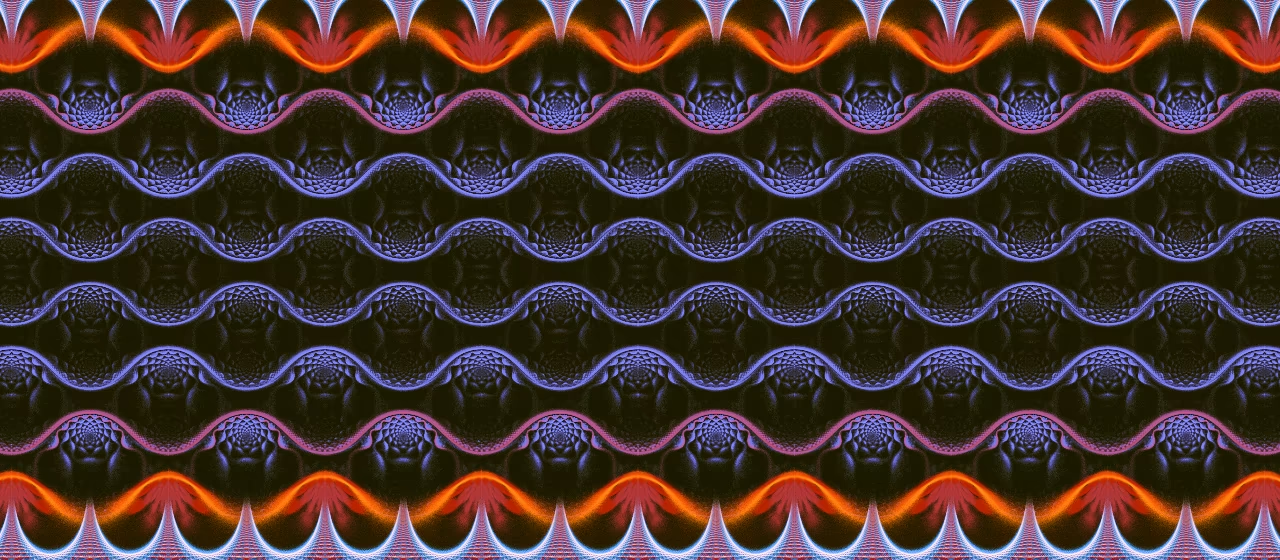
Faiblement éclairé par quelques allumettes, trouvées miraculeusement dans mes poches, je confondais les murs intérieurs et extérieurs ; je ne les distinguais plus. En voulant les distinguer, je voulais leur fabriquer une égalité. Je passais du dedans au-dehors sans m’en apercevoir. Profondeurs et distances étaient la cause de mes errances. Je trouvais, enfin, une pièce, richement ornée, située dans un entre deux perpétuel, ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans.
Une table tenait fièrement en son dessus quelques livres, ouverts et fermés. Je lisais des pages emplies de signes incompréhensibles, des pages vides où rien semblait être inscrit. Des objets angulaires et sphériques dont je ne comprenais pas les indications végétaient à côté des livres. Peut-être les fameux solides platoniciens. Non fini était l’infini, je le percevais, à la fois comme un espace et une temporalité. Je désirais le finir comme on parcourt un chemin entre deux points.
Ces objets, ces livres, sont les vestiges inscrits de quelque chose qui ne veut pas s'oublier. Ils sont les clés d'un savoir perdu. Mais ce savoir, quel qu'il soit, n'est pas une unique accumulation des faits de l'expérience. Il est aussi une transformation intérieure, une arborescence de l'imaginaire. Il faut laisser les mots s'effacer, laisser les images se dissoudre. Il faut devenir le livre, devenir l'image, l'inscription, l'écrit.
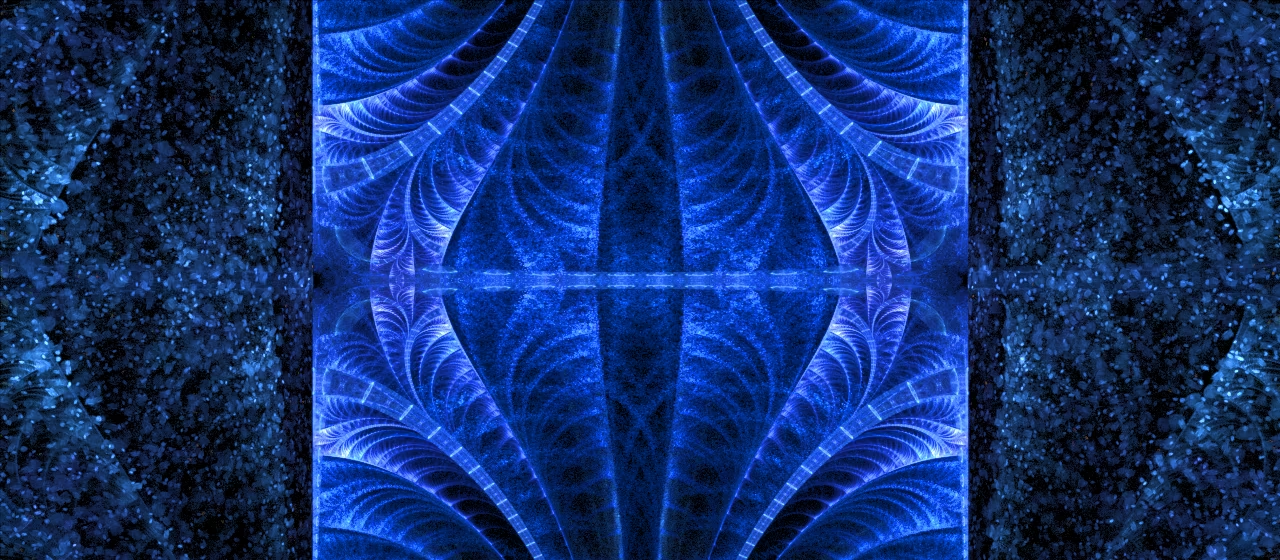
Mes doigts me rappelèrent la combustion rapide de l'allumette. Plongé dans le désarroi le plus profond, je n’avais presque plus d’allumettes, je ne pouvais plus rien voir. Le geste de ma main échauffée par la fin de la lumière, bouscula maladroitement quelques livres, des bougies roulèrent. Je m’empressais d’en allumer une. Je plaçais les autres dans deux poches différentes de ma veste.
Je regardais enfin ce labyrinthe avec un peu plus d’acuité, ma curiosité pénétrait son ambiguïté. Les parois que je distinguais formaient aussi bien un contour extérieur qu’intérieur. Mes avancées, quelques peu modifiées par ces différents éclairages, ne me servaient pas réellement ; au contraire elles m’embrouillaient. Il paraissait bien plus complexe que je ne le pensais. Sa complexité transparaissait comme un art de faire éclore ce qui ne veut pas se dévoiler, ce qui veut rester caché, secret.
Les murs se transformaient continuellement, fabriquant de nouvelles pièces où vides et emplis se déroulaient, s’étalaient tels des ornements à la fois obscurs et clairs ; un bruit sourd, d’une rare intensité, quasi vivant, m’extirpait de mes pensées et de moi-même. Il semblait proche et lointain. Je ne pouvais me fier à la structure sonore du labyrinthe. Ses tours et détours sont tellement vastes que je me perdais sans raison apparente. Ses chemins alimentent mon parcours, mais, cette fois-ci, ce bruit, si terrible, me tira hors de moi-même. Au bout de quelques déambulations, plus ou moins hasardeuses, je découvrais l’origine de ce son : bruit électrique d’un mécanisme. Longue et périlleuse découverte.
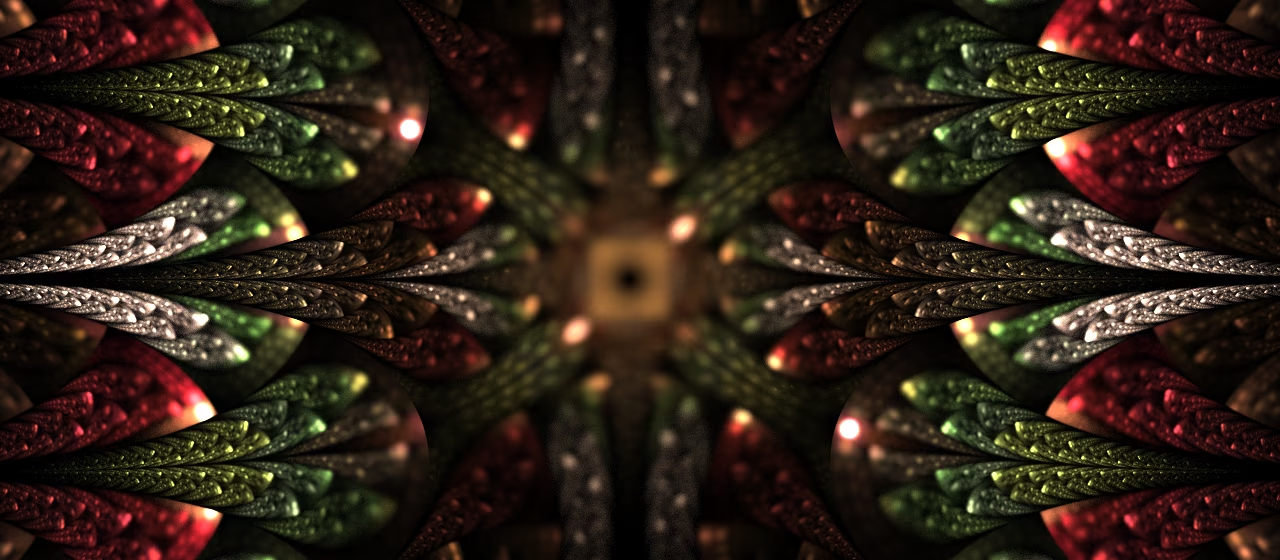
Je n’avais presque plus de bougies. La dernière consumait sa fin, son reste, ses derniers instants. Après une étude approfondie, le fonctionnement de ce mécanisme électrique me semblait évident. Je n’avais plus le temps d’en comprendre ses rouages et ses mécanismes, la bougie finissait son chant de lumière. Les rouages et les cliquetis s’activaient en appuyant sur un bouton et une lumière constante, presque infinie, douce et agréable transformait les murs et la nature même du labyrinthe. Elle m’habituait aux configurations entrelacées de ce dernier. De nouvelles salles se construisaient par cette distinction lumineuse, entrecoupées de salles d’errances, plus vastes et sombres encore où même la lumière ne parvenait pas à les éclairer.
J’avançais dans la profondeur des profondeurs, là où la pression se faisait telle que je n’arrivais plus à distinguer la peur de la joie, le courage de la lâcheté, la force de la faiblesse, l’échec de la victoire. J’étais dans l’un des cœurs circulaires du labyrinthe où la possibilité d’en franchir le seuil s’amenuisait à chaque pas. Je devais gravir un autre seuil en m’appuyant sur ce que je savais ; me nourrir n’était plus suffisant, il fallait que je m’extirpe de ce lieu. Une étrange force s’imposait à moi. De ce que j’étais, de ce que je savais, je construisis une échelle dont les barreaux, solides et sûrs, me permirent de sortir de cette salle d’errance sans que je sache où était le haut et le bas, le dedans et le dehors.
Enfin, je retournais à la première salle, celle dont le centre est partout et les murs nulle part. J’y retrouvais la table, mais il n’y avait plus rien dessus. Elle était vide. De nouvelles indications apparaissaient sur les murs ; inscriptions qui traversaient le dedans comme le dehors. Elles m’étaient incompréhensibles. Parmi elles, je reconnus sur chaque mur, d’abord l’étincelle, puis l’allumette, la bougie, l’ampoule électrique : naissance du temps, furtivité du temps, maîtrise du temps, illusion de l’éternité. Toutes ces temporalités ne se séparaient jamais de leurs espaces.
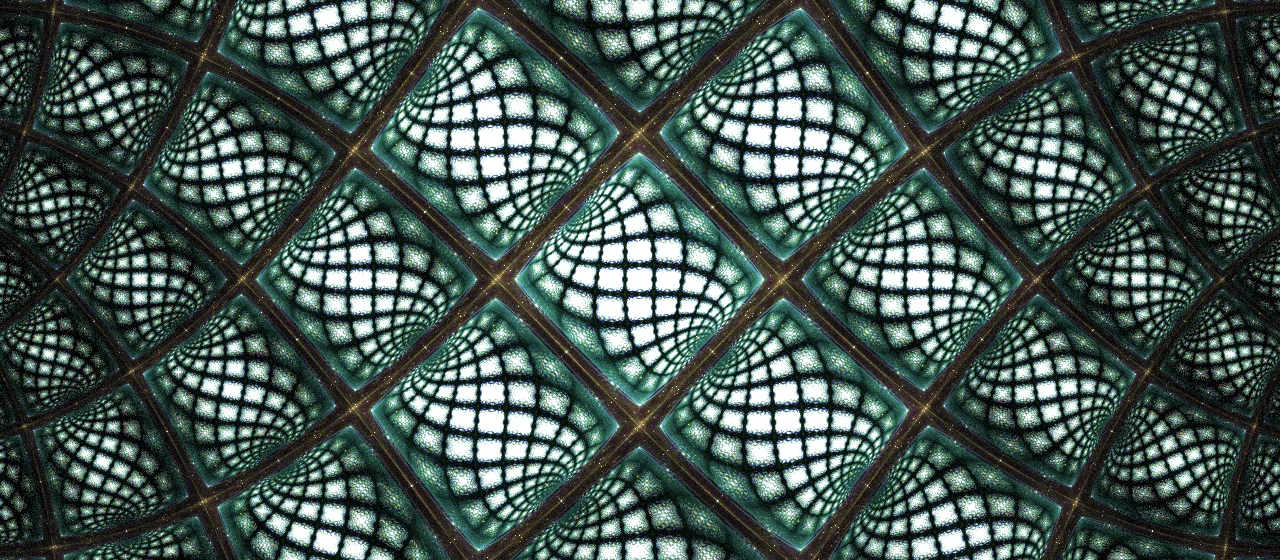
Avec le premier mur, je voyais une faible lueur dans le noir le plus sombre. Le second me renvoyait à moi-même, les signes indiquaient mon parcours et me plongeaient dans d’infinies questions. Le troisième me livra un kaléidoscope d’une beauté incroyable, inimaginable. Fasciné, émerveillé, éveillé par sa beauté je m’endormis dans un nuage d’une douceur inexprimable. Mais le bruit incessant des technologies mécaniques me réveilla jusqu’à ce que le son-silence de la lumière me mette hors de moi-même. Sur le dernier mur, les inscriptions avaient disparu. Il ne restait plus que la lumière et le vide qui l’entourait telle une force mystérieuse qu’elle ne parvenait pas à éclairer.
Plus j’explorais ce côté clair-obscur, plus je percevais son immensité. Je frémissais à l’idée de sentir, aussi près de moi, quelque chose d’infini, sans début ni fin, sans extérieur ni intérieur, sans surface ni contour, sans rien et pourtant c’était là. Je ne voyais plus de haut ni de bas ni de droite ou de gauche, je ne voyais rien. Ce que je suis ne peut plus me servir à comprendre cela. Une phrase, lointaine, furtive, fragile m’invitait à rendre ce qui m’avait été donné.
Par cette longue exploration, durant des heures impassibles, j’avais oublié que plus rien ne m’éclairait. J’étais dans le silence le plus profond, le plus absolu, je me remémorais l’ensemble de mon parcours : l’étincelle, l'allumette, la bougie, l’ampoule électrique. Tout cela m’avait permis de voir, de prendre conscience de moi-même, du monde environnant, des objets. « Je ne peux fixer la lumière, mais elle me sert à voir les objets qu’elle éclaire. Elle projette un monde qui la reflète. L’étincelle, l'allumette, la bougie, l’ampoule électrique sont les objets de la lumière que je tiens et je vois le monde comme si je n’étais pas avec lui, mais en-dehors de lui. » Balbutiais-je timidement.

La lumière perce les ténèbres, révèle les formes, donne une dimension au monde. Mais elle est aussi une prison. Elle enferme les choses dans une image, les fige dans le temps. Pour comprendre l'immédiateté, il faut s'extraire de la lumière, plonger dans l'ombre. Il faut devenir aveugle pour voir.
Je suis pris au piège de mes propres constructions, de mes propres illusions, coincé quelque part, dans un entre deux où ce que je sais me divise autant qu'il divise l'unité du monde. Je cherche une issue, une vérité, un sens. Mais ce que je découvre n'est qu'une forme chimérique de la vérité, cette fameuse vérité. Elle se dérobe, se transforme, se multiplie.
En me rappelant les scènes de la vie quotidienne, je comprenais que l’immédiateté de la vie était impossible à saisir. Je ne pouvais qu’en traduire une abstraction, un résumé, un schéma. Cette traduction indiquait un ensemble de relations auxquelles j’attribuais un sens magique parce que rien ne les distinguait du reste. Il me fallait prendre du recul par rapport à cette immédiateté continuelle pour que je puisse saisir sa présence dans le temps et ma présence en ce lieu.
Je transformais en une abstraction ce qui se présentait à moi, cette abstraction devenait une représentation. Dédoublement de l’immédiateté qui ne pouvait plus l’être par ma transformation personnelle. Je transfigurais le monde en transmuant son existence, en l’observant (comme la lumière qui éclaire) puis en l’inscrivant sur un support (schématiquement, je devenais, moi-même, lumière qui éclairait les objets figurés de ma pensée ; il n’y avait qu'un langage qui pouvait les comprendre).
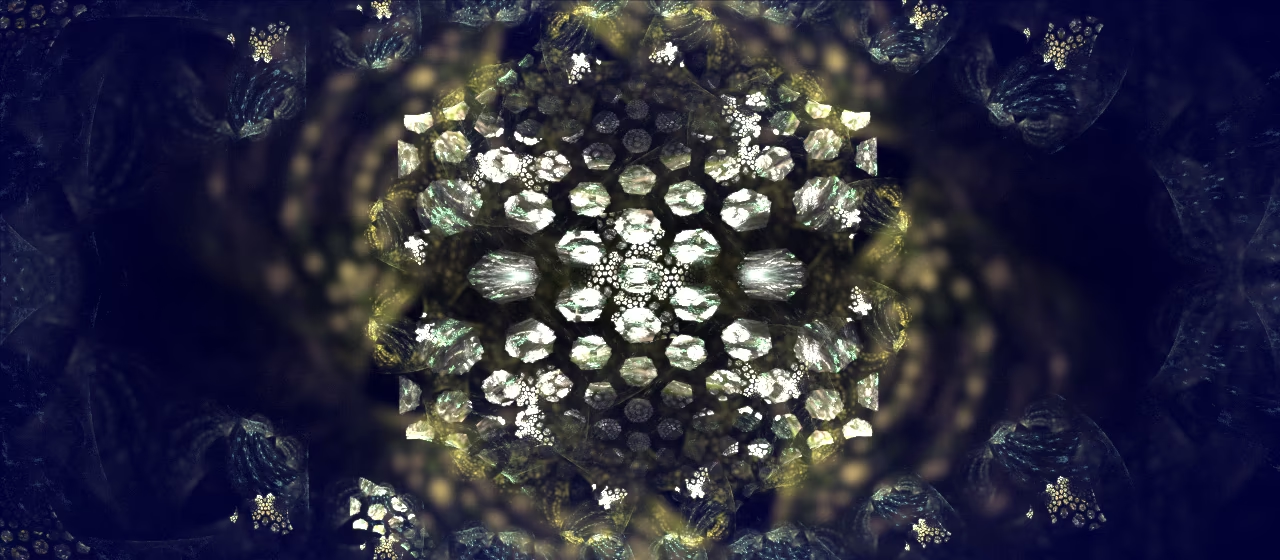
Un bruit sourd, traversant l’ensemble du labyrinthe et de mon corps, s’éleva du plus lointain et indiscernable monde découvert. Les premiers rayons du soleil franchissaient les parois devenues translucides. Elles disparaissaient tel un mécanisme qui s'ajustait au jour ; je n'avais plus besoin d'étincelles, d'allumettes, de bougies ou d'électricité. Je respirais, à nouveau, le doux air de la vallée des évocations. Le labyrinthe s’estompait : dedans voyait dehors et dehors visitait dedans. Tout était à nouveau en place. Je retrouvais la grotte de mes premières inscriptions. Tout était là, devant moi.
Je créais une structure narrative qui allait devenir et mon histoire et l'histoire des recettes qui expliquent tout. La pierre de la grotte devenait un support qui allait me servir de mémoire pour raconter. J’avais créé des abstractions qui, plus tard, beaucoup plus tard, se nommeraient alphabet, connaissance, ignorance. Une histoire apparaissait devant mes yeux et je peux la conter.
Mais voici : chaque récit engendre son propre dédale. La phrase lue construit un labyrinthe. Les mots en sont ses murs. Les signes de ponctuation, des tournants, des bifurcations, des croisements, des arrêts. La conjugaison, l'apparente maîtrise des temporalités, et, je suis et le Minotaure et le fil d'Ariane et Thésée. À la fois le monstre qui dévore le sens, le fil qui trame l'histoire, et le héros qui cherche la sortie. La recette n'est pas une solution, mais une ré-solution : une dis-solution du même mystère. Celui d'un monde scindé en perceptions multiples qui cherchent à s'unir dans une même cohérence.
Ces abstractions, je les voyais naître comme des bulles d'air dans une eau trouble. Elles se détachaient du chaos, s'organisaient en constellations, puis se dissolvaient à nouveau. La connaissance, l'ignorance, le langage… autant de tentatives de donner un sens à ce qui n'en a presque pas. Même si ce fameux sens est une illusion. Il n'y a que des relations, des connexions, des flux et des reflux.
Un nouveau labyrinthe arrive, différent du premier. Ainsi se perpétue la loi des cycles, de labyrinthes en labyrinthes, jusqu’à l’infini, peut-être, sauf que dans ce dernier, il ne semble pas y avoir de sortie vers un autre labyrinthe parce que personne n'a, jusqu'à présent, trouvé la recette adéquate.
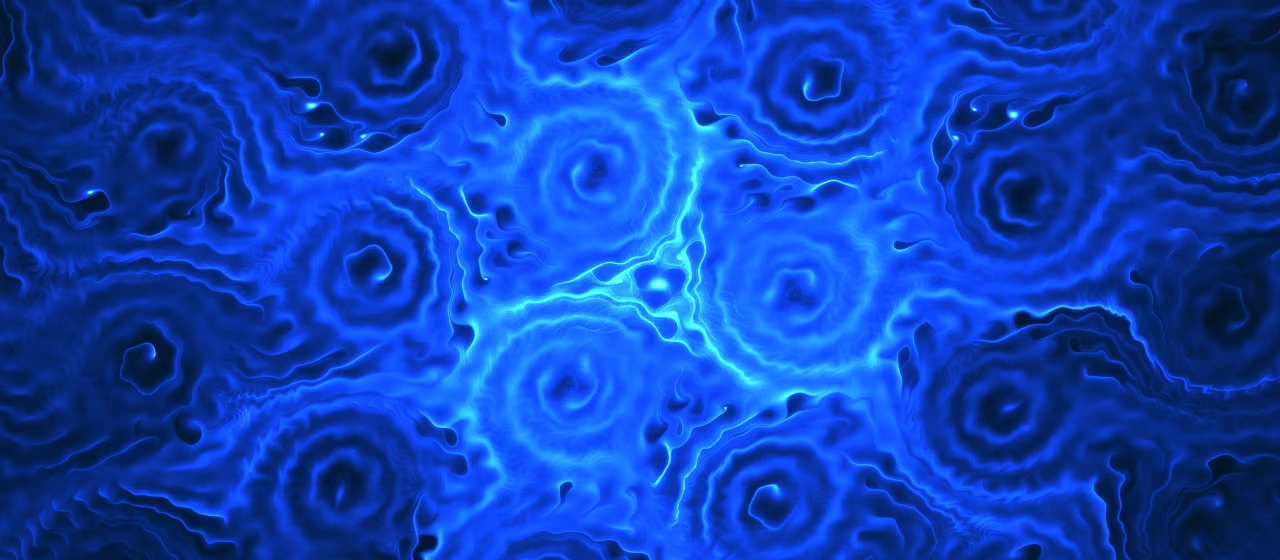
Elle n'est pas une formule, mais une déperdition infinie du sens à la recherche de sa définition. Il faut se perdre soi-même dans la traduction transposée du savoir scindé par l'immédiateté et sa projection graphique qui la représente en un instant fini localement, mais infini lorsqu'il se détache du lieu. Il faut devenir cet intraduisible, cet inexprimable de l'entre deux mondes afin de connaître et parler leurs langues qui ne se ressembleront jamais. Le labyrinthe de la véritable définition n'a pas de centre ; il est le centre qui erre à jamais, celui qui ne peut jamais se finir.
Peut-être que la sortie est en arrière, en avant, sur le côté ou nulle part. Peut-être qu'il faut revenir aux grottes, non pas pour voir les dessins, mais pour redevenir la main qui projetait des graphismes abstraits d'une expérience vécue intérieurement parce qu'elle cessait d'écrire des histoires et devenait l'histoire elle-même — celle qui se raconte à elle-même dans le silence des origines.
L'infini ne se finira jamais ; il s'affine. Il se lie à nos récits comme une ombre fraternelle. Il est possible de l'effeuiller au sein de nos ouvrages. Chaque page est l'étincelle de l'infini. Chaque mot une pâle lueur à peine allumée. Chaque phrase, une lumière qui borde la sombre vacuité. Chaque récit est la technologie fabriquée. Elle nous permet de percevoir le livre dans son entièreté — un foyer où brûle l'être même du monde.
Il est le chiasme, ce point unique, mais éparpillé en une multitude rapprochée où plusieurs mondes s'observent dans le miroir de l'autre en une vague infinie dont la houle est le discret moteur d'une technologie qui n'existe pas, mais est édictée par une mécanique céleste. Les solides rouages qui se construisent ne sont pas des idées pures, mais des désirs solidifiés et stratifiés, des limites. Elles se présentent, comme fruits de l'absolu, nourries sur la branche du langage figurant le vide de futures pages encore plus lourdes que les autres : elles contiennent tous les livres, à jamais, non écrits.
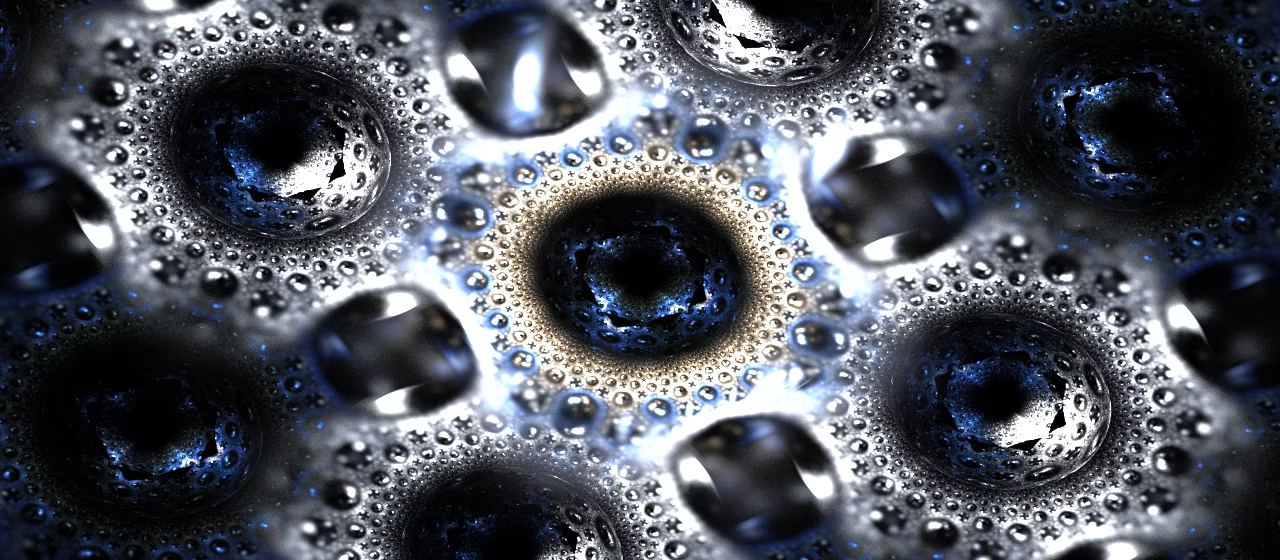
Le savoir est le geste du photographe qui, pour fixer l'instant, le tue et le ressuscite comme ombre tracée et transfigurée. L'immédiat est un serpent qui se mord la queue : dès qu'on le nomme, il n'est plus, mais une autre boucle transparaît au même moment de sa disparition continuant son fragile chant, mais perpétuel et infini lequel apparaît puis disparaît, apparaît puis disparaît, ad vitam æternam.
Certains ayant observé cela ont eu la malencontreuse idée de nommer cette continuelle contradiction des états en paradoxe d'infinité où il pouvait se mesurer comme prise sur le réel : passé, présent, futur, et, d'en faire une ligne… Remplacer un simple mouvement réel par un concept d'une impossible réalité qui jamais ne se loge dans le lieu même du réel.
Tout cela n'est que la répétition qui se perpétue depuis des millénaires : imitations impossibles du vivant, imitations impossibles de la mécanique céleste en savoirs et connaissances qui ne peuvent que mesurer et penser que tout cela oscille entre plusieurs états. Elles passent de mémoires en mémoires puis de projections en livres, cherchant dans ces imitations la simple force de la vie qui ne trouve forme dans le lieu représenté du réel, mais uniquement dans sa distribution imaginée vraie, la réalité. Alors cette formulation redevient l'acte fondateur d'une création qui se vit.
La mémoire s'associe aux projections graphiques, aux pages, aux luminosités sans être un réservoir, mais une distillerie qui dissout le labyrinthe : elle transforme l'eau vive de l'expérience en alcool brûlant du sens qui s'étale sur une fine plaque. Elle s'apprête à recevoir le travail comme un miroir. Sur une face, la forme la plus sombre sur laquelle balbutie l'écume blanche du ressac des parfums aux goûts des sens. Sur l'autre face se dessinent les couleurs du reflet et forment un paysage.
Plus c'est fort, plus c'est faux, et, plus c'est vrai, plus c'est réel.